

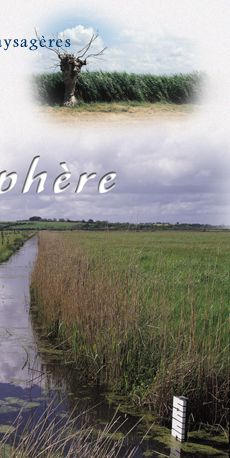



 |
||||||||||||
 |
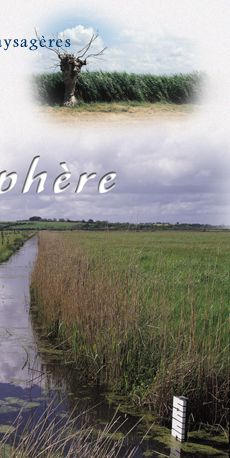 |
|||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
 |
||||||||||||
![]() La
tradition picturale
La
tradition picturale
Alors
que s'affirme le goût pour cette peinture de genre, l'art du paysage se renouvelle
au XIXe siècle. Il tire sa force d'un sentiment neuf de la nature porté par
le mouvement romantique. à la différence de la tradition classique qui enseigne
des vérités morales par l'exposition de paysages symboliques et de grands
sites antiques peuplés de personnages mythologiques, la nouvelle école s'efforce
moins de convaincre que de restituer une expérience vraie, simple, directe
de la nature.
En France vers 1830, à Fontainebleau, Théodore Rousseau entouré de Daubigny,
Diaz, Dupré, Millet... et Corot à la marge du groupe, anime l'école de Barbizon
qui annonce l'impressionnisme. Elle a son représentant à Nantes en la personne
de Charles Le Roux (1814-1895) qui possède une propriété à Corsept près de
Paimboeuf, où il reçoit Corot - des fresques décoratives témoignent de ce
passage.
Là, il découvre l'estuaire de la Loire dont il rend les atmosphères dans de
grands formats, remarquables par le travail de la lumière et par la construction
de l'espace du tableau dominé par les ciels. Il compose de grandes étendues
en privilégiant les vues du fleuve, des rives, des îles et des bras de Loire.
Avant de s'illustrer au sein de l'école de Pont-Aven, le peintre Maxime Maufra
s'inspire lui aussi des paysages de l'estuaire et emprunte au style à Le Roux,
qui l'a d'ailleurs soutenu dans ses débuts vers 1880. Maufra traite également
les bords de Loire, les prés-marais, ces terroirs marqués par l'élément aquatique.
Avec d'autres, qui ont développé une manière personnelle, tel Edmond Bertreux
par exemple, ils ont créé les oeuvres originales d'un vaste corpus iconographique
de peintures, de dessins, d'aquarelles ou de vues photographiques qui reproduisent
les motifs désormais identifiés des paysages de l'estuaire.
![]() Nouvelles
approches paysagères
Nouvelles
approches paysagères
A la croisée
de nombreuses disciplines – écologie, géographie, ethnologie...-, l'approche
paysagère permet d'appréhender un territoire dans sa globalité. Dessinées
par différents facteurs naturels (climat, géologie, biologie...), les grandes
lignes du paysage donnent naissance à la trame sur laquelle l'homme inscrira
son histoire au fil des siècles.
Né d'une lente évolution, ce paysage d'estuaire se découpe en trois entités
:
![]() Paysage de bocage
Paysage de bocage
A
l'abri des caprices de la Loire et des inondations hivernales, ce territoire
a été rapidement colonisé par l'homme. Il s'étend sur le coteau dès la rive
du marais et sur les "îles" de terres cultivables cernées de prairies humides.
La toponymie témoigne de cette opposition îlot/terre inondable (Moulin de
l'île, Port de l'île...). Bordés de haies d'ormes, de chênes et de frênes
têtards, les chemins ombragés serpentent sur les rives et les îles pour déboucher
sur les exploitations agricoles. Ce tissu bocager enserre dans ses mailles
des parcelles de pâturage et de céréales diverses.
![]() Paysage de prairie
Paysage de prairie
Calmes et planes, les prairies sont découpées géométriquement par un réseau
de canaux bordés d'iris, de joncs et de roseaux. Les nombreuses vannes qui
ponctuent ces longs filets d'eau permettent d'imbiber le sol, offrant ainsi
un excellent herbage aux vaches qui y paissent. Devant cette étendue verte,
le regard se fixe au loin. Il accroche une ligne de peupliers bordant le canal
maritime, le clocher de Vue, la tour de Buzay...
![]() Paysage de rive
Paysage de rive
Présence diffuse, presque secrète dans les prairies, l'eau devient élément
clé à l'approche du rivage. Marée basse et odeur de vase... marée haute...
roseaux ondulant au gré du vent... envol lourd d'un couple de hérons... Dans
ce paysage mouvant, la nature semble vouloir défaire l'histoire : les piquets
de clôtures envasés deviennent des perchoirs à mouettes, les vannes se déchaussent
et le tracé des canaux s'efface sous les manteaux d'alluvions... Seuls demeurent
les frênes alignés, sentinelles de bois veillant sur les travaux des anciens
magiciens d'eau...
![]() La
vision de l'artiste : Denis Clavreul
La
vision de l'artiste : Denis Clavreul
Peintre naturaliste contemporain, Denis Clavreul exerce ici son regard et son art sur les marais du golfe du Tenu et les ouvrages d'art du canal maritime de la Basse-Loire.Avec une grande économie de moyens, propre au dessin et à l’aquarelle, une finesse d’observation, bénéfice d’une longue pratique d’artiste et de naturaliste, il nous restitue une vision humaniste de la nature. ôtant au patrimoine architectural son caractère monumental ou pittoresque, il nous rend un bâti exact, familier, intégré aux paysages intimes de notre mémoire.